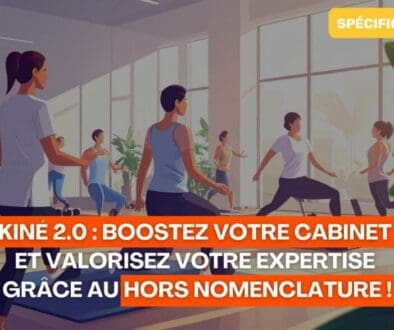L’entraînement en résistance sur-vélo : Une nouvelle perspective pour la performance et la prévention des blessures chez les cyclistes ?
Traditionnellement, l’amélioration de la force et de la performance chez les cyclistes a souvent été associée à l’intégration d’un entraînement en résistance « hors-vélo ». Ces méthodes visent à développer la puissance musculaire nécessaire pour surmonter les défis du cyclisme. Cependant, une question pertinente émerge : et si une approche plus spécifique, réalisée directement sur le vélo, pouvait offrir des bénéfices équivalents, voire supérieurs, tout en présentant moins de risques ?
Cet article se propose d’explorer des découvertes scientifiques récentes qui remettent en question la nécessité exclusive de l’entraînement de force traditionnel pour les cyclistes bien entraînés. Pour les kinésithérapeutes, comprendre ces avancées est crucial pour affiner les programmes d’entraînement de leurs patients cyclistes, optimiser leurs performances et, surtout, pour une prévention et une gestion plus efficaces des blessures spécifiques à cette discipline.
L’étude qui bouscule les habitudes : « L’entraînement sur-vélo, une alternative à part entière »
Une étude contrôlée randomisée récente, intitulée « Cyclists do not need to incorporate off-bike resistance training to increase strength, muscle-tendon structure, and pedaling performance: Exploring a high-intensity on-bike method« , menée par Jesús G Pallares et al. de diverses institutions de recherche et universitaires en Espagne, y compris le Human Performance and Sports Science Laboratory de l’Université de Murcie et l’Université Européenne de Madrid, a cherché à comparer l’efficacité de l’entraînement en résistance (RT) de haute intensité réalisé hors-vélo et sur-vélo.
L’étude a impliqué trente-sept cyclistes bien entraînés. Ces participants ont été répartis en trois groupes pour une période de 10 semaines, chacun intégrant un protocole spécifique à sa routine cycliste habituelle :
- Groupe « Hors-vélo » (off-bike RT) : Composé de 12 cyclistes, ce groupe a effectué un entraînement en résistance de haute intensité consistant en des flexions complètes (squats complets).
- Groupe « Sur-vélo » (on-bike RT) : Comprenant également 12 cyclistes, ce groupe a réalisé un entraînement en résistance de haute intensité via des efforts de pédalage « all-out » intenses.
- Groupe Contrôle : Ce groupe de 13 cyclistes a poursuivi sa routine cycliste habituelle sans ajouter de stimuli d’entraînement en résistance.
Il est important de noter que les variables de l’entraînement en résistance telles que l’intensité (% de la force dynamique maximale – MDF), le volume, le nombre de séries et le temps de repos étaient identiques entre les groupes « Hors-vélo » et « Sur-vélo ». De plus, le volume de cyclisme à chaque zone d’intensité a été équilibré entre les trois groupes pour garantir une comparaison équitable.
Des résultats surprenants : Égalité des bénéfices, avec un avantage pour la sécurité
Les conclusions de l’étude ont révélé des résultats frappants pour les kinésithérapeutes et les entraîneurs :
- Comparabilité des méthodes : L’une des découvertes majeures est qu’aucune différence significative n’a été observée entre l’entraînement en résistance hors-vélo et sur-vélo pour aucun des paramètres mesurés. Cela suggère une efficacité comparable des deux approches.
- Améliorations communes aux groupes d’entraînement en résistance (RT) :
- Les deux groupes d’entraînement en résistance ont montré une augmentation de la puissance aérobie maximale (ES ≥ 0.37).
- Une amélioration de la puissance atteinte au point de compensation respiratoire (RCP) a également été constatée (ES ≥ 0.20).
- La force dynamique maximale (MDF) hors-vélo a été significativement renforcée par les deux groupes RT (ES ≥ 0.16).
- Des améliorations considérables, bien que non statistiquement significatives, de la capacité d’endurance jusqu’à l’épuisement (ES ≥ 0.30) ont été observées dans les deux groupes RT.
- Avantages spécifiques de l’entraînement sur-vélo :
- Le groupe « Sur-vélo » a montré une augmentation significative de la puissance atteinte au seuil ventilatoire (ES = 0.24).
- Il a également augmenté significativement la MDF de pédalage (ES = 0.67).
- Une tendance à l’augmentation de la taille du quadriceps (ES = 0.15) et de l‘épaisseur du tendon rotulien (ES = 0.35) a été observée dans le groupe « Sur-vélo ». Notons que le groupe « Hors-vélo » a, lui, augmenté significativement la taille du quadriceps (ES = 0.22).
- Quid des blessures ? Un point particulièrement pertinent pour les kinésithérapeutes est que le groupe pratiquant l’entraînement hors-vélo a montré une tendance à l’augmentation des symptômes liés aux blessures (ES ≥ 0.33). Cette tendance n’a pas été observée pour le groupe « Sur-vélo ».
- L’effet du non-entraînement : Le groupe contrôle, qui n’a pas inclus d’entraînement en résistance additionnel, a constaté une diminution significative de la MDF hors et sur-vélo (ES ≤ -0.40) ainsi qu’une réduction de la taille du quadriceps (ES = -0.26).
Implications pour les kinésithérapeutes : Repenser la prise en charge des cyclistes
Ces découvertes ont des implications profondes pour la pratique de la kinésithérapie et l’accompagnement des cyclistes :
- Une alternative efficace et sûre : L’étude suggère que l’entraînement en résistance de haute intensité sur-vélo est une alternative efficace et sûre pour améliorer la force, la structure musculo-tendineuse et la performance cycliste. Cela signifie que les kinésithérapeutes disposent désormais d’une option validée pour leurs patients.
- Prévention des blessures : La tendance à l’augmentation des symptômes de blessures observée avec l’entraînement hors-vélo est un signal d’alerte. La méthode sur-vélo pourrait être privilégiée pour réduire ces risques tout en atteignant des objectifs d’optimisation de la force, un aspect essentiel de la prévention des blessures cyclistes.
- Spécificité de l’entraînement : Pour les cyclistes, un entraînement spécifique au mouvement de pédalage est souvent recherché. L’entraînement sur-vélo répond parfaitement à cette exigence, permettant un transfert direct des gains de force vers la performance cycliste.
- Guidance personnalisée et optimisation : Les kinésithérapeutes sont idéalement placés pour intégrer ces découvertes dans leurs programmes. Ils peuvent proposer des séances de force sur-vélo adaptées aux besoins et aux objectifs spécifiques de leurs patients cyclistes, qu’il s’agisse d’améliorer la performance ou de faciliter un retour progressif après une blessure. De plus, l’entraînement sur-vélo, souvent réalisable avec un home-trainer, peut offrir une solution pratique et motivante pour de nombreux cyclistes, optimisant ainsi leur temps et leurs ressources.
- Considérations importantes : Bien que l’étude compare des entraînements de haute intensité, il est essentiel de souligner l’importance d’une progression individualisée, d’une bonne technique et, si possible, d’une supervision professionnelle, pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques.
Conclusion : L’avenir de l’entraînement de force cycliste est peut-être déjà sur la route (ou le home-trainer)
En conclusion, l’entraînement en résistance sur-vélo représente une voie prometteuse pour les cyclistes. Il offre des bénéfices comparables à l’entraînement hors-vélo en termes de performance et de développement musculaire, avec un profil de sécurité potentiellement supérieur, notamment en ce qui concerne les symptômes de blessures.
En tant que professionnels de la santé et du mouvement, les kinésithérapeutes sont vivement encouragés à intégrer cette perspective innovante dans leur arsenal thérapeutique et d’accompagnement sportif. Cette approche ouvre la porte à des programmes de force plus spécifiques, potentiellement plus sûrs et plus accessibles, permettant aux cyclistes d’améliorer leur force et leurs performances de manière optimale.
Références
- Pallares, J. G., et al. (2025). Cyclists do not need to incorporate off-bike resistance training to increase strength, muscle-tendon structure, and pedaling performance: Exploring a high-intensity on-bike method. Biol Sport, 42(3), 185-195. doi: 10.5114/biolsport.2025.146790. eCollection 2025 Jul. PMID: 40657002.
- Lien vers l’article